Portrait de l'entreprise contemporaine
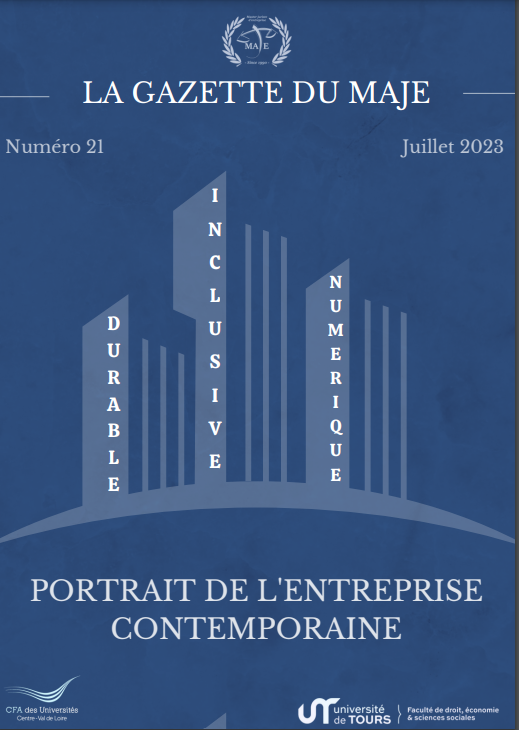
Si le proverbe qui dit qu’il faut vivre avec son temps peut paraitre désuet, il semble aujourd’hui plus actuel que jamais pour les entreprises qui doivent s’adapter à un monde en perpétuelle mutation. Or, s’il faut du courage pour faire évoluer un individu, il en faut encore plus pour faire changer un écosystème aussi complexe que celui d’une entreprise. Pourtant, alors que le quart du XXIè siècle est bientôt atteint, la loi, l’économie et la morale poussent les entreprises à avancer à marche forcée sur des chemins incompatibles. On attend d’elles qu’elles prennent le virage du numérique, s’engagent dans la transition écologique tout en répondant aux défis sociaux de notre temps. En d’autres termes, on attend de l’entreprise qu’elle continue à satisfaire l’ensemble des parties prenantes à son écosystème tout en relevant le défi de la modernité. Voilà pourquoi, sans jamais prétendre à l’exhaustivité, la team édito vous propose ce semestre un portrait des défis que relève quotidiennement l’entreprise contemporaine. Elle a de plus le plaisir d’accueillir dans cette édition les vainqueures du concours de rédaction organisé ce semestre qui vous présentent leur article sur le recul de la participation citoyenne à la justice criminelle. Bonne lecture !
Le monde du numérique a récemment été bouleversé par l’arrivée d’une intelligence (IA) nommée ChatGPT. En quelques mois seulement, depuis son lancement en novembre 2022, l’outil a atteint en début d’année 2023 plus de 100 millions d’utilisateurs.

Qu’est-ce que ChatGPT ?
Il s’agit d’une intelligence artificielle développée par l’entreprise américaine OpenAI fondée par Elon Musk et Sam Altman.
En réalité, ChatGPT est un type de ChatBot qui permet de poser des questions et de faire des requêtes en langage naturel (et non par mots-clés) via une interface de saisie.
L’outil effectue alors une recherche dans de très grands volumes de données en un temps record (quasi instantané), et les résultats sont délivrés sous la forme d’une réponse structurée en langage naturel[1]. Bien que son utilisation fasse encore l’objet de nombreuses controverses, l’outil développé par OpenAI s’insère déjà dans notre quotidien et dans le monde professionnel. En effet, plusieurs salariés indiquent l’utiliser pour l’aide dans la réalisation de certaines tâches.
Par conséquent, il apparait important de se questionner sur l’utilisation qui peut être faite de ChatGPT en entreprise, les différents risques que cela peut entrainer et voir comment les entreprises peuvent se protéger contre ces risques.
Quel intérêt d’utiliser ChatGPT en entreprise ?
À l’image de toute intelligence artificielle, on peut tout de suite imaginer que ChatGPT peut servir à améliorer l’efficacité et la productivité de certaines entreprises. En effet, l’outil peut surtout être utilisé pour rédiger et générer du contenu dans des domaines diversifiés. Certains salariés l’ont déjà intégré pour effectuer des tâches fastidieuses telles que la rédaction des mails types, des newsletters[2], la génération de contenu marketing, la recherche de contenu scientifique, ou encore pour la rédaction de messages de prospection commerciale.
Grâce à l’outil, les entreprises peuvent gagner du temps dans des tâches chronophages et facilement automatisables.

Toutefois, il convient de souligner que ChatGPT ne peut être utilisé par les entreprises pour prendre des décisions importantes sur les personnes notamment dans le cadre de recrutement. En effet, la CNIL rappelle qu’une « conversation avec un chatbot sans intervention humaine ne peut conduire à elle seule à des décisions importantes pour la personne concernée »[3].
Dans ce cadre, il faut rappeler que l’utilisation de ChatGPT en entreprise n’est pas sans risque.
Les risques liés à l’utilisation de ChatGPT en entreprise
Rappelons d’abord que l’outil développé par OpenAI utilise la méthode de « scraping »[4] qui consiste à extraire des données sur Internet afin de les utiliser pour s’entrainer. Par conséquent, ces données peuvent contenir des informations erronées ou approximatives. Il y a donc un risque pour les entreprises d’utiliser et de relayer des informations fausses fournies par l’IA.
Ces risques sont d’autant plus avérés puisque OpenAI met en garde les utilisateurs sur le fait que ChatGPT peut « occasionnellement générer des informations incorrectes, produire des instructions nuisibles ou du contenu biaisé »[5].
Par ailleurs, les professionnels du droit ont très rapidement souligné l’absence de protection des données à caractère personnel traitées par ChatGPT. En effet, il semble que la politique de confidentialité de l’outil ne respecte pas les dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Notamment, « elle ne fait pas mention au droit à la limitation du traitement, la durée de conservation des données traitées, le droit de limitation et de portabilité des données »[6]. Ainsi, les entreprises qui utilisent ChatGPT et soumettent à l’outil les données personnelles des clients, sans pour autant informer ces derniers, s’exposent à un risque de contentieux et d’atteinte à l’image.
Les moyens d’encadrement par les entreprises
Pour éviter d’utiliser et de relayer des informations erronées ou biaisées, les salariés qui utilisent ChatGPT en entreprise doivent vérifier et contextualiser les informations que l’outil fournit avant de l’utiliser de manière professionnelle[7].
De plus, pour ne pas s’exposer au risque de contentieux, d’aucuns recommandent aux entreprises qui l’utilisent de modifier leur charte informatique « pour rendre obligatoire la déclaration de toute utilisation de ChatGPT par un salarié »[8]. Au surplus, les entreprises qui utilisent ChatGPT ne doivent surtout pas lui soumettre des données à caractère personnel.
Pour finir, l’intégration de ChatGPT dans le monde professionnel peut présenter des réels avantages pour les entreprises. À condition que ces derniers adoptent différentes mesures pour encadrer cette utilisation afin de ne pas s’exposer à différents risques.
Références
[1] « Harvey, une solution d’intelligence artificielle dédiée aux avocats », Miren Lartigue, Gazette du Palais, 14 mars 2023, n° GPL446o7.
[2] « ChatGPT : utilisations et risques en entreprise », Marie-Laure Tredan, Lexplicite, 9 mai 2023
[3] CNIL, « Chatbots : les conseils de la CNIL pour respecter les droits des personnes »,19 février 2021
[4] Intelligence artificielle – ChatGPT et le marché du droit – Etude par Bruno Deffains, La Semaine Juridique Edition Générale n° 13, 03 avril 2023
[5] Introducing ChatGPT (openai.com)
[6] ChatGPT et RGPD : la protection des données personnelles. Par Debora Cohen, (village-justice.com)
[7] « ChatGPT quels enjeux juridiques ? », Par Pascal Alix, Village de justice, 2 février 2023.
[8] « ChatGPT : utilisations et risques en entreprise », Marie-Laure Tredan, Lexplicite, 9 mai 2023
La définition du data center
L’expression « data center » désigne en français un « centre de données ». Il s’agit d’une infrastructure physique, d’un espace de stockage tangible, permettant de collecter et de conserver des données numériques qui sont donc pour leur part immatérielles. Le stockage de ces données ne constitue pas la seule activité des data centers qui permettent aussi de les traiter, de les partager et de les analyser. Il est possible de retrouver au sein des data centers des ordinateurs et des serveurs agglomérés dans des salles et qui fonctionnent en permanence.
Face au développement rapide des nouvelles technologies et au besoin croissant des entreprises en termes de capacité de stockage, les data centers représentent pour les entreprises des solutions fiables et stables pour héberger leurs données. Les fabricants de data centers misent ainsi sur la flexibilité, l’adaptabilité, l’optimisation de gestion de leur environnement informatique. Parmi les entreprises possédant une part importante des data centers, il est possible de retrouver Google, Microsoft ou encore Amazon. Cependant, les data centers soulèvent de nombreux débats au sujet de leur impact environnemental qui n’est pas à négliger.
La pollution provoquée par les data centers
Les data centers sont détenus par les entreprises ayant besoin de stocker leurs données grâce à ce type d’infrastructures. On dénombre dans le monde « […] 4798 data centers dont plus de 500 sont appelés des « hyperscale » » c’est-à-dire des structures « de grande taille détenues par les grandes entreprises » dont 149 se trouvent en France selon le site Greenly[1].
Bien qu’il soit parfois difficile d’estimer exactement le nombre de data centers dans le monde, la Bibliothèque Publique d’Information recensait en 2021 un nombre proche de celui évoqué ci-dessus et précise que la localisation des data centers « tient compte des facilités d’accès (routes, aéroports, réseaux) mais aussi des coûts (taxes, coût de l’énergie) et des conditions météorologiques[2] ».
Le numérique, enjeu majeur du droit moderne ayant connu un véritable essor en termes de réglementation juridique depuis le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018 et les droits et devoirs s’y rattachant, soulève également de nombreuses questions relatives à son impact environnemental. En effet, les données numériques et leur gestion polluent et ce, tout particulièrement à travers les nouvelles technologies proposant pour les entreprises et les sociétés de plus en plus de fonctionnalités, d’outils et de possibilités de stockage.
Selon une étude [3] menée par l’ADEME et l’ARCEP datant de 2022, le numérique serait à l’origine de 2,5% des émissions carbone de la France. Les data centers seraient eux à l’origine de 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales atteignant de fait le même niveau que le transport aérien. Si la tendance ne s’inverse pas dans les prochaines années, les prévisions estiment que ce chiffre pourrait atteindre les 14% d’ici 2040 [4].
En effet, les data centers nécessitent pour leur bon fonctionnement un processus d’alimentation en énergie abondante. Les espaces de stockage restent toujours en activité pour permettre aux entreprises d’avoir accès aux données nécessaires de façon permanente. De fait, l’électricité est une donnée nécessaire au maintien de ces espaces et bien que certains se fournissent aujourd’hui en énergies renouvelables, nombreux sont ceux qui utilisent encore exclusivement des énergies fossiles polluantes à court et long termes [5].

Sur la totalité de l’électricité consommée au niveau mondial, 4% est le fruit de l’activité des data centers selon le cabinet Wavestone[6] et cela risque encore de grimper car selon les prévisions affichées par le groupe ENGIE : « le volume de données stockées prévu pour 2025 devrait être 3,5 fois plus [élevé] qu’en 2018[7] ». De plus, le fonctionnement des data centers induit un niveau thermique élevé s’accentuant au fur et à mesure de leur fonctionnement provoquant ainsi un risque de surchauffe de trop grande ampleur.
Le refroidissement des data centers est donc une étape cruciale à ne pas négliger pour éviter cette surchauffe et leur détérioration. Les data centers sont par conséquent inévitablement des consommateurs d’eau, cette dernière étant utilisée pour permettre le refroidissement nécessaire.
Au sein de son ouvrage “Réparer le futur du numérique à l’écologie”, Inès Leonarduzzi, expose quelques chiffres : « les 800 data centers implantés en Californie nécessitent, annuellement, pour fonctionner, la même quantité d’eau que l’équivalent de 158 000 piscines olympiques ». Pour un seul data center, « c’est l’équivalent des besoins en eau annuels de trois hôpitaux ».
De facto, les entreprises se doivent d’être toujours plus inventives en matière de gestion de leurs centres de données, et pour preuve : Microsoft a installé un de ses data centers, comprenant 864 serveurs, en mer, au large des côtes écossaises afin de trouver un système de refroidissement naturel pour ses serveurs[8]. Cette installation est certes ingénieuse et permet de remédier à un certain nombre de questions et de problématiques environnementales, mais en soulève d’autres également du fait de l’installation de toutes ces données et machines en milieu marin.
Les data centers qui représentent d’un côté l’avancée de entreprises vers le « cloud » et la nécessité de moins de papier, de documents tangibles, constituent également une véritable problématique en termes d’émission de gaz à effet de serre, de réchauffement climatique et plus largement d’impact environnemental.
Le droit de l’environnement en entreprise
Les data centers, du fait de leur impact écologique et financier indéniable, sont au cœur de divers débats. Le rapprochement avec la matière qu’est le droit de l’environnement est donc non seulement flagrant mais nécessaire. Les entreprises se doivent de façon générale d’analyser leur impact environnemental et social afin de limiter au mieux les externalités négatives de ceux-ci. Les entreprises utilisant des data centers, ou gérant de façon plus vaste des données, ont donc une variable polluante de plus à prendre en compte. En effet, le droit de l’environnement ne connaît pas de frontières et touche de façon transversale tous les domaines du droit ainsi que les différents États de la planète tous touchés par les problématiques liées à l’environnement.
Il s’agit aujourd’hui d’un droit à valeur constitutionnelle en France : ce dernier étant entré en 2005 dans la Charte de l’environnement qui dispose dans son article premier que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé ».
Le Conseil Constitutionnel a même consacré cette notion en sacralisant cet objectif comme ayant une valeur constitutionnelle [9]. Les entreprises et les sociétés doivent aujourd’hui prendre en compte ces enjeux et ces impacts en s’y adaptant de la façon la plus efficiente qui soit.
Les notions environnementales occupent désormais une vraie place dans le débat public et dans la vie des entreprises. Il est notamment possible de citer la loi Biodiversité n°2016-1087 du 8 août 2016 « pour la reconquête de la biodiversité » visant tout particulièrement les entreprises.
A titre d’illustration, l’article 69 de cette loi [10] instaurant dans le code de l’environnement un Chapitre III intitulé « Compensation des atteintes à la biodiversité »,
vise à mettre en œuvre certaines mesures de compensation des atteintes causées à l’environnement. Il est par exemple possible de citer l’article L.163-3 du code de l’environnement[11], instauré par cette loi, qui fait référence aux opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité pouvant être mises en place par des personnes publiques comme privées.
Les entreprises ne peuvent plus fermer les yeux sur l’urgence climatique certaine, décrite par de très nombreux scientifiques et observée chaque jour par les populations du monde entier. Face à des rapports alarmants, à l’image de celui du GIEC[12], la société, les associations, les citoyens poussent, au travers d’actions diverses, les juges à prendre position et à jouer un rôle décisif dans la protection de l’environnement. Aujourd’hui, les États mais aussi les entreprises et particulièrement les grandes multinationales sont visées par un nombre d’actions en justice grandissant. Il est, entre autres, possible de citer l’entreprise SHELL enjointe le 26 mai 2021 par le tribunal de première instance de La Haye à réduire de 45% ses émissions de gaz à effet de serre.

La loi du 21 juillet 2017 consacre le devoir de vigilance des sociétés mères et multinationales en matière de droit de l’environnement. Le devoir de vigilance est fondé sur les deux premiers articles de la Charte de l’environnement.
En effet, ces deux articles invoquent respectueusement que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé » et que « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ». Le devoir de vigilance peut notamment être rapproché de ses voisins, le devoir de précaution et de prévention visant à empêcher la création ou l’aggravation de dommages environnementaux donc l’existence est ou non déjà démontrée.
En vertu de ce devoir, les entreprises se doivent de prévoir au mieux l’impact environnemental et social de leurs activités. Tout laisse donc à penser que les grandes entreprises possédant une majeure partie des data centers du globe doivent indéniablement lutter contre la pollution, les émissions de gaz à effet de serre émises via ces structures en raison de leurs opérations. Les données stockées par les entreprises constituent un véritable maillon de leur chaîne de production, d’analyse, etc. Il est donc légitime de penser et de suggérer que ce devoir de vigilance s’applique également en matière de pollution numérique des entreprises.

Les contentieux fondés sur le droit de l’environnement sont aujourd’hui de plus en plus fréquents et il est aisé de faire le rapprochement entre les grands principes consacrés par ce droit, cette lutte de plus en plus prégnante au sein de la société et les atteintes causées à l’environnement par l’utilisation grandissante du numérique en entreprise et particulièrement l’utilisation des data centers et le stockage des données de façon générale. Il est donc nécessaire que les entreprises envisagent ces enjeux dans leur globalité et prennent conscience de la place relativement grande des outils numériques dans la pollution générale qu’elles produisent.
Les solutions possibles
Il est souhaitable que les entreprises sensibilisent leurs salariés aux enjeux environnementaux, les forment et adoptent des processus et des gestes plus écologiques. Limiter l’empreinte numérique des entreprises est aujourd’hui une priorité. Ainsi, en parallèle des gestes écoresponsables faciles à adopter, des hébergeurs de données écoresponsables se développent, à l’image des centres de données fonctionnant à l’énergie renouvelable, neutre en carbone et cherchant à réduire ses émissions [13].
À l’heure où les accords de Paris [14] visent à contenir le niveau du réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius supplémentaires, il est urgent d’agir. Le 29 mars 2023, les députés du Parlement européen ont reconnu le délit d’écocide et ont demandé son inscription dans le droit européen afin que les crimes et les délits environnementaux soient durement réprimés à l’échelle européenne. Selon Marie Toussaint, eurodéputée EELV « [si le texte était adopté, les écocides pourraient alors faire l’objet de] sanctions à la hauteur de la gravité de ces crimes » [15].
Références
[1] DUMONT Justine “Qu’elle est l’empreinte carbone d’un data center?” GREENLY, 29 septembre 2022, consultable sur : https://greenly.earth/fr-fr/blog/actualitesecologie/quelle-est-l-empreinte-carbone-d-undata-center
[2] “Où sont situés les data center? ” Balises BPI, 13 août 2021, consultable sur : https://balises.bpi.fr/ou-sont-les-datacenters/
[3] ADEME ET ARCEP, “Evaluation de l’impact environnemental du numérique en France et analyse Prospective”, ARCEP, 29 janvier 2022, consultable sur :https://www.arcep.fr/ uploads/tx_gspublication/etude-numeriqueenvironnement-ademe-arcep-notesynthese_janv2022.pdf
[4] Joarson “Data Center: impact sur l’environnement et solutions possibles” Le Big Data 18 mars 2021 consultable sur : https://www.lebigdata.fr/data-center-impactenvironnement
[5] COLIN Alizée, “Quel est l’impact environnemental des DATA Centers ?” Digital For Planet 25 avril 2021 Consultable sur : https://lebondigital.com/datacenters-quellepart-dans-la-pollution-numerique/
[6] BEMBARON Elsa “La consommation d’eau des data center , source d’inquiétude” Le Figaro 19 août 2022 Consultable sur : https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/laconsommation-d-eau-des-data-centers-sourced-inquietudes-20220819
[7] “Optimiser la consommation des data centers pour un digital plus green” ENGIE 2022. consultable sur : https://www.engie.com/activites/data-centers
[8] “Microsoft installe un Data Center sous la mer.” le monde 7 juin 2018 consultable sur : https://www.lemonde.fr/pixels/video/2018/0 6/07/microsoft-installe-un-data-center-sousla-mer_5311360_4408996.html
[ 9 ] L a p r o t e c t i o n d e l’e n v i r o n n e m e n t . C o n s e i l c o n s t i t u t i o n n e l. C o n s u l t a b l e s û r : https://www.conseil-constitutionnel.fr/la- constitution/la-protection-de-l- environnement#:~:text=Plus%20récemment%2 C%20c%27est%20à,QPC%20du%2031%20janvier %202020).
[10] Article 69 de la LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
[11] Article L163-3 du code de l’environnement
[12] “Ce qu’il faut retenir du 6ème rapport d’évaluation du GIEC” Ministère de la transition écologique, 2023, consultable sur : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/fil es/20250_4pages-GIEC-2.pdf
[13] voir n°1
[14] Les accords de Paris ont été adoptés le 12 décembre 2015 et sont entrés en vigueur le 4 novembre 2016, consultable sur https://unfccc.int/process-and-meetings/the- paris-agreement
[15] SERVIA Florent “Environnement : le Parlement européen reconnaît le crime d’écocide” Actu.fr 30 mars 2023, consultable sur :https://actu.fr/planete/climat/environnement -le-parlement-europeen-reconnait-le-crime-d- ecocide_58518455.html
La crise climatique impacte tous les domaines d’activités et invite les entreprises à revoir leurs modes de production. L’environnement s’immisce peu à peu dans le Droit, et particulièrement le droit du travail.
La loi climat et résilience du 22 août 2021[1] a doté le CSE de compétences environnementales : prise en compte des impacts environnementaux des décisions de l’entreprise lors de la représentation collective des salariés, information et consultation sur les conséquences environnementales des mesures intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise[2]… Pour autant, du point de vue du contenu des accords collectifs, il y a peu de dispositifs qui obligent les partenaires sociaux à négocier en faveur de l’environnement. Ce n’est pas en effet un thème obligatoire de négociation à proprement parler.

L’actualité montre par ailleurs, la difficulté des partenaires sociaux à conclure des accords réellement contraignants. Un Accord National Interprofessionnel (ANI) sur la transition écologique et le dialogue social[3] a cependant été conclu le 11 avril dernier. Certaines organisations syndicales reprochent à cet accord de ne créer aucune nouvelle norme, et de n’être qu’une synthèse des lois environnementales précédentes. Pour la CGT il ne s’agit que « d’un rappel de la loi Climat, et un guide de bonnes pratiques »[4].
Typologie des accords collectifs environnementaux
Néanmoins la pratique montre que des accords collectifs « verts » émergent progressivement, faisant de l’entreprise un lieu au cœur des enjeux écologiques. Véritables normes vertes ou expression du « greenwashing », il convient d’étudier ces différents types d’accords. Il peut s’agir d’accords concernant la mobilité du salarié, d’accords récompensant des comportements vertueux dans l’entreprise, d’accords de formations environnementales, d’accords dotant les Instances Représentatives du Personnel (IRP) de moyens environnementaux importants… Le rapport « Agreenment » recense ces clauses vertes que l’on trouve dans différentes sources du droit (conventions collectives, accords collectifs, chartes)[5]…
Les accords concernant la mobilité représentent un réel enjeu, en raison de l’interdiction progressive des véhicules polluants. En effet, « un pourcentage de salariés ne pourra plus venir travailler sur son lieu de travail. La mobilité des collaborateurs sera alors un vrai enjeu, il faut rappeler qu’il n’y a que 43 % des emplois en France qui sont télétravaillables »[6].

Les accords de mobilité peuvent consister en des indemnités pour les salariés utilisant des modes de transport écologiques : transports en commun, véhicules électriques, vélos… A cette fin, a été créé un dispositif de forfait mobilités durables[7]. Ce forfait est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 700 euros par an et par salarié. Il peut être cumulé avec d’autres dispositifs de mobilités durables, tels que l’indemnité kilométrique vélo ou la prise en charge partielle de l’abonnement aux transports en commun.
Ces accords peuvent également consister en la mise en place de bornes de recharge pour les salariés utilisant des véhicules électriques. Toujours du point de vue de la mobilité, certains accords collectifs peuvent décider de recourir au télétravail en cas de pic de pollution, dans un objectif de protection des salariés. D’autres accords peuvent consister à créer des espaces de coworking, proches du domicile des salariés, pour éviter des déplacements trop longs et par conséquent polluants.
En outre, dans les entreprises et groupes d’au moins 300 salariés, à défaut d’accord collectif, il y a une obligation de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) tous les 3 ans. (Code du travail art. L2242-20[8]). Selon cet article, la GEPP doit répondre « aux enjeux de la transition écologique ».
Mais les accords liant l’environnement et les compétences sont généralement rédigés de façon floue comme en témoigne l’exemple suivant, tiré d’un accord GEPP : « Les actions en faveur de l’emploi et des investissements de recherche et développement devraient nous permettre de faire face au défi incontournable de la transition écologique que doit relever notamment le transport aérien. Plus particulièrement, toutes actions conduites pour renforcer et adapter les compétences dans le cadre de ce plan d’adaptation et de relance seront portées et discutées dans le cadre notamment de la commission centrale d’anticipation Groupe »[9].
Les accords dotant les IRP de moyens plus importants peuvent consister en la création de commissions facultatives, telles que la commission environnement.
Les accords peuvent également aménager la Base de Données Economiques, Sociales, et Environnementales (BDESE) pour qu’elle soit fournie en matière environnementale et que l’information soit accessible et lisible pour l’ensemble de l’entreprise.
Du point de vue de l’adoption des comportements responsables dans l’entreprise, il peut être envisagé par accord collectif de former les responsables et les salariés aux impacts environnementaux de leurs activités et les inciter à adopter des comportements propres. A ce titre, peuvent être envisagés des primes pour les salariés polluant peu, des formations au tri des déchets, des activités de recyclage… La sobriété énergétique dans le recours aux mails et l’utilisation des outils numériques en général est aussi un sujet intéressant la négociation collective.
Tous ces exemples d’accords cités sont intéressants sur le principe mais méritent d’être interrogés. Valoriser les modes de transports verts par les forfaits mobilités durables peut potentiellement creuser un fossé entre des salariés ayant un niveau de vie différent. A titre d’illustration, un salarié ayant des revenus modestes aura davantage de difficultés à se procurer un véhicule électrique qu’un salarié plus fortuné. De ce point de vue, octroyer des primes au regard du véhicule peut être discutable.
Installer des bornes de rechargement pour les véhicules électriques peut également creuser un fossé entre les salariés ayant un niveau de vie différent et pose la question de savoir si les véhicules électriques sont réellement écologiques. L’impact environnemental des voitures électriques peut en effet interroger au regard de la fabrication et la décomposition des batteries.
Néanmoins, selon l’ADEME (agence de la transition écologique), sur l’ensemble de sa durée de vie et en considérant qu’elle va rouler 200 000 km, « une voiture électrique roulant en France a un impact carbone 2 à 3 fois inférieur à celui d’un modèle similaire thermique »[10]. De ce point de vue, installer des bornes de recharges pour les voitures électriques de l’entreprise peut apparaître comme une mesure pertinente.
Le recours au télétravail, pour éviter des déplacements polluants suscite également des interrogations. Il faut en effet avoir à l’esprit que la pollution numérique induite par le recours au télétravail doit être un enjeu auquel il faut tenir compte dans les négociations. Selon l’ADEME, le numérique est responsable de 4% des gaz à effet de serre au niveau mondial, et de 8% d’ici 2025[11].
Enfin, les accords collectifs « verts » sur le fonctionnement des IRP présentent une limite en ce qu’ils créent « une dimension environnementale dans les missions de l’instance représentative sans pour autant leur attribuer un rôle très actif. Les dispositions conventionnelles sur le sujet sont rédigées de manière très évasive et concernent les domaines de l’information et de la consultation »[12].
Quel avenir pour les accords environnementaux ?
Il reste que la négociation collective est un moyen primordial pour assurer la transition écologique des entreprises, en associant toutes les parties. Mais ces accords restent encore minoritaires dans la plupart des pays : moins d’un quart (23%) des accords analysés par le Rapport sur le dialogue social 2022 de l’OIT aborde les aspects environnementaux[13].
Références
[1] LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFT EXT000043956924
[2] Code du travail, article L2312-8
[3] Accord national interprofessionnel du 11 avril 2023 relatif à la transition écologique et au dialogue social https://web.lexisnexis.fr/LexisActu/ANItransition.pdf
[4] Site internet de la CGT, « L’ANI prend le mauvais virage de la transition écologique en entreprises », 25 avril 2023, consultable en ligne https://www.cgt.fr/actualites/france/interpr ofessionnel/ecologie/lani-prend-le-mauvaisvirage-de-la-transition-ecologique-enentreprises
[5] Alexis Bugada, Véronique Cohen-Donsimoni, Vanessa Monteillet, Caroline Vanuls, Audrey Martinez. Agreenment (Environnement et négociation collective), Rapport de synthèse droit français. [Travaux universitaires] AMU – Aix Marseille Université. 2020. consultable en ligne https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal03030535/document
[6] Aymeric d’Alençon, Alice de Rocca-Serra, Nicolas Fourmont, « Un bilan en demi-teinte des accords collectifs sur la mobilité domiciletravail » Semaine Sociale Lamy, 1er mai 2023, https://www-lamyline-fr.proxy.scd.univtours.fr/Content/Document.aspx? params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEwMDA3 MjIyszBQK0stKs7Mz7MNy0xPzStJVUvJTw6pLEi 1NQQAV9-sSioAAAA=WKE
[7] Code du travail, article R3261-13-2
[ 8 ] C o d e d u t r a v a i l, a r t i c l e L 2 2 4 2 – 2 0
[ 9 ] N i c o l a s F o u r m o n t, « L a p r i s e e n c o m p t e d e s e nj e u x d e t r a n s i t i o n é c o l o g i q u e d a n s l e s a c c o r d s s u r l a G E P P », S e m a i n e S o c i a l e L a m y, 1 e r m a i 2 0 2 3, h t t p s:/ / w w w – l a m y l i n e – fr.p r o x y.s c d.u n i v – t o u r s.fr / C o n t e n t / D o c u m e n t.a s p x ? p a r a m s = H 4 s I AAAAAAA E A M t M S b F 1 C T E w M D A 3 Mj I y s z B Q K 0 s t K s 7 M z 7 M N y 0 x P z S t J V U v J T w 6 p L E i 1 N Q Q AV 9 – s S i o AAAA = W K E
[ 1 0 ] Av i s d e l’A g e n c e d e l a t r a n s i t i o n é c o l o g i q u e ( A D E M E ), « M o n d i a l d e l’a u t o m o b i l e : l’A D E M E p u b l i e s o n a v i s s u r l e v é h i c u l e é l e c t r i q u e : u n e b a t t e r i e d e t a i l l e r a i s o n n a b l e a s s u r e u n e p e r t i n e n c e c l i m a t i q u e e t é c o n o m i q u e », 1 2 o c t o b r e 2 0 2 2, c o n s u l t a b l e e n l i g n e : https://presse.ademe.fr/2022/10/mondial- de-lautomobile-lademe-publie-son-avis-sur- le-vehicule-electrique-une-batterie-de-taille- raisonnable-assure-une-pertinence- climatique-et-economique.html
[11] Infographie de l’Agence de la transition écologique (ADEME), « Comment télétravailler léger ? », 14 janvier 2021, consultable en ligne : https://librairie.ademe.fr/consommer- autrement/249-comment-teletravailler- leger-.html
[12] Benoit Masnou, « Le CSE à l’heure de la loi Climat », Les cahiers Lamy du CSE, 01/10/2021,
[13] Rapport sur le dialogue social de l’organisation internationale du travail (OIT), « La négociation collective pour une reprise inclusive, durable et résiliente », 2022, p.98,
Le réchauffement climatique représente un défi majeur pour les entreprises. En effet, selon le CDP Carbon Majors Report, celles-ci seraient responsables de plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Face à ce constat, le législateur a pris conscience du rôle crucial que les entreprises devaient jouer dans la transition écologique et a commencé à légiférer en ce sens au début du 21ème siècle. En 2017, est promulguée la loi dite Vigilance qui impose aux grandes sociétés de prendre en compte les risques d’atteinte aux droits humains et à l’environnement liés à leur activité. Cette loi est actuellement au cœur d’un contentieux sans précédent en matière environnementale, mettant ainsi en cause les plus grandes multinationales.
La loi Vigilance, c’est quoi ?
La loi Vigilance a vu le jour à la suite d’un drame : l’effondrement en 2013 du Rana Plaza, un immeuble de huit étages qui abritait des usines textiles de fournisseurs de grandes marques européennes dans la ville de Dacca au Bangladesh. Les donneurs d’ordre déclinaient toute responsabilité au motif qu’ils n’avaient pas connaissance de la sous-traitance réalisée en cascade par les sous-traitants de premier rang. Face à la situation d’impunité dont ont pu bénéficier les entreprises européennes, des correctifs juridiques ont vu le jour. D’une part, au niveau international, un accord sur la sécurité des incendies et des bâtiments au Bangladesh a été signé en 2013. D’autre part, en France, une loi introduisant un devoir de vigilance à la charge des sociétés a été promulguée le 27 mars 2017.
Cette loi impose à l’égard des sociétés les plus importantes d’établir et de respecter un plan de vigilance permettant « d’identifier les risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement[1] ». Plus en détail, le plan doit contenir les cinq mesures suivantes : une cartographie des risques, des procédures d’évaluations régulières de la situation des filiales, des fournisseurs ou des sous-traitants, des actions d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves, un mécanisme d’alerte relatif à l’existence de risques et un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre.
Les sociétés soumises à cette obligation sont celles dont le siège social est fixé en France et qui emploient au moins cinq mille salariés ou au moins dix mille salariés si le siège social est fixé à l’étranger. La spécificité de cette loi est qu’elle concerne à la fois les activités de la société donneuse d’ordre mais également les activités de ses filiales ou des sociétés qu’elle contrôle ainsi que les activités de ses fournisseurs ou de ses sous-traitants avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie. Autrement dit, la société donneuse d’ordre soumise à cette obligation de vigilance est responsable de tous les manquements commis par l’ensemble des acteurs de la chaîne de production.
A première vue, cette responsabilité étendue semble être un véritable fardeau pour la société sur qui elle pèse. En réalité, il n’en est rien. L’association Amnesty International révélait en 2019 que sur les quatrevingt plans de vigilance analysés, « la plupart ne répondent que très partiellement aux exigences de la loi, notamment en termes d’identification des risques de violations, de leur localisation et des mesures mises en œuvre pour les prévenir ».[2] Pire encore, elle révèle que certaines sociétés, soumises à ce devoir de vigilance, n’avaient toujours pas publié de plan, alors même que celui-ci devait faire l’objet d’une publication en janvier 2018. Le problème, c’est qu’il n’existe pas d’autorité compétente chargée de vérifier que les plans de vigilance soient conformes à la législation en vigueur. Dès lors, il ne reste qu’une seule issue : le contentieux.

Les prémices du contentieux climatique européen
Auparavant, les contentieux climatiques s’exerçaient le plus souvent à l’encontre des États. En témoigne, l’affaire Urgenda dans laquelle le tribunal de première instance de La Haye avait condamné le 24 juin 2015 l’État Néerlandais pour son inaction climatique et lui avait enjoint de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 25% d’ici 2020 [3]. Cette affaire avait provoqué une onde de choc en Europe, et plus précisément en France. À la suite de la victoire des militants écologistes néerlandais, des associations et communes françaises ont décidé à leur tour, d’assigner l’État français pour ses manquements en matière de lutte contre le changement climatique. Face à l’influence de la juridiction néerlandaise, deux affaires françaises vont être jugées dans le même état d’esprit que la décision Urgenda.
D’une part, le Conseil d’État, dans sa décision Commune de Grande Synthe du 1er juillet 2021, a enjoint à l’État français de prendre des mesures supplémentaires d’ici le 31 mars 2022 pour atteindre la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030[4]. Le 10 mai 2023, le Conseil d’État a procédé à l’examen des actions menées par l’État depuis sa décision.
La haute juridiction administrative a relevé que « si des mesures supplémentaires ont bien été prises et traduisent la volonté du Gouvernement d’exécuter la décision, il n’est toujours pas garanti de façon suffisamment crédible que la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre puisse être effectivement respectée ». Ainsi, le Conseil d’État a ordonné au Gouvernement de prendre « de nouvelles mesures d’ici le 30 juin 2024, et de transmettre, dès le 31 décembre, un bilan d’étape détaillant ces mesures et leur efficacité [5]».
D’autre part, par deux jugements rendus le 3 février et le 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a reconnu pour la première fois que l’État était responsable d’un préjudice écologique du fait du non-respect des objectifs fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’a condamné à le réparer[6].
Si ces affaires sonnaient comme une véritable victoire pour les militants écologistes, celles-ci demeuraient insuffisantes dès lors que seul l’État était condamné. Il fallait aller encore plus loin et rechercher la responsabilité des acteurs de premier plan du changement climatique. Dès lors, le manquement au devoir de vigilance semblait être l’argument de taille permettant d’ouvrir la voie au contentieux climatique dans le secteur privé.
La condamnation historique de Shell
Le 5 avril 2019, l’association de protection de l’environnement néerlandaise Milieudefensie a assigné la société pétrolière Shell afin que celle-ci prenne des mesures supplémentaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi contenir le réchauffement climatique à 1,5°C. Par un jugement en date du 26 mai 2021, le tribunal de première instance de La Haye se fonde sur le principe de « duty of care » (qui est l’équivalent du devoir de vigilance français) pour condamner la société Shell à réduire ses émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes d’au moins 45% en 2030[7]. Il faut comprendre par « directes et indirectes », les émissions produites par l’entreprise Shell mais également celles de toutes ses filiales, au nombre de 1100, de ses fournisseurs et soustraitants. Les juges vont encore plus loin puisqu’ils considèrent que Shell est également responsable des émissions résultant de l’utilisation de ses produits par les clients. Cette décision historique, condamnant pour la première fois une entreprise multinationale sur le terrain de la responsabilité climatique, n’est pas sans rappeler la jurisprudence Urgenda. La question qui demeure à cet égard est de savoir si cette décision aura ou non des répercussions dans le reste de l’Union Européenne. Paul Mougeolle, juriste pour l’association « Notre affaire à tous » semble être catégorique à ce sujet en affirmant que « Si les entreprises ne prennent pas acte de ce jugement, nous multiplierons les moyens judiciaires pour faire reconnaître cette décision en France »[8].

Total Energies pris pour cible
Total Energies a publié son premier plan de vigilance en mars 2018. Plusieurs associations de défense de l’environnement et des collectivités territoriales ont constaté, concernant les projets Tilenga et Eacop, des insuffisances en matière de prévention des atteintes graves aux droits humains et à l’environnement. Ces deux chantiers visent d’une part à forer environ 400 puits en Ouganda pour en extraire 200 000 barils de pétrole par jour et d’autre part à construire un oléoduc chauffé à 50°C afin d’éviter la solidification du pétrole.
Selon les associations, ces projets aboutiraient à l’émission de plus de 34 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, à la destruction de la faune et la flore, à l’expropriation de milliers d’habitants dont des agriculteurs privés de leurs terres ainsi que de la pollution des cours d’eau. Le 24 juin 2019, elles ont donc mis en demeure la société pétrolière d’établir un plan conforme aux exigences de la loi dite Vigilance. Face aux arguments de défense de la direction, les associations de défense de l’environnement ont assigné Total Energies devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 octobre 2019 et ont demandé la révision du plan pour que figurent les risques d’atteintes graves associés aux projets, la mise en œuvre de mesures de vigilance et d’urgence (telles que le versement immédiat des compensations, et des distributions de nourriture) ainsi que la suspension des travaux.
Le 30 janvier 2020, la juridiction saisie se déclare incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre[9]. Cette position sera confirmée par deux arrêts de la Cour d’appel de Versailles[10]. La Cour de cassation quant à elle, reconnait, une option de compétence entre le tribunal civil ou le tribunal de commerce[11]. Toutefois, cet arrêt sera partiellement remis en cause par une loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire qui confie les actions relatives au devoir de vigilance au tribunal judiciaire de Paris. Désormais, deux possibilités s’offrent au demandeur : celui-ci peut aussi bien saisir la juridiction compétente (soit le tribunal judiciaire de Paris) que le président du tribunal statuant en référé. En l’espèce, les associations de protection de défense de l’environnement avaient opté pour la voie du référé et espéraient ainsi obtenir une décision plus rapidement.
Par deux arrêts rendus le 28 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes des associations[12]. D’une part, il relève qu’aucune nouvelle mise en demeure n’avait été réalisée par les requérants depuis 2018 alors même que les associations fondaient leurs critiques sur le plan de vigilance de 2021. D’autre part, le juge des référés rappelle qu’il ne relève pas de sa compétence de régler lui-même le litige au fond. En effet, la procédure de référé est une procédure dite d’urgence qui permet de faire cesser un trouble illicite ou prévenir un dommage. Cet examen appartient au seul juge du fond qui sera à même d’apprécier ou non la pertinence du plan de vigilance.
D’autres contentieux sont en cours et concernent de nombreuses multinationales telles que Casino, ou BNP Paribas, pour ne citer qu’eux. Désormais, il est fort à parier que seul le juge du fond sera saisi pour régler les questions relatives à la mise en œuvre des obligations de vigilance. Plus encore, il appartient à ce dernier de choisir quelle suite il souhaite donner à ce contentieux : prendra-t-il la même voie que le juge néerlandais, comme a pu le faire le juge administratif français, ou bien suivrat-il sa propre logique ? Seuls les prochains contentieux nous le diront.
Un pas en avant pour l’Union européenne
Il est à noter que le 1er juin 2023, la Commission des affaires juridiques du Parlement européen a voté en faveur de la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Au regard de ce texte, les entreprises européennes et non européennes actives sur le marché européen, de plus de 250 salariés et, réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros devront s’assurer du respect des droits humains et environnementaux par leurs filiales, leurs fournisseurs ou encore leurs sous traitants. Grâce à ce vote, le Parlement, la Commission européenne et le Conseil européen vont pouvoir entamer rapidement des négociations en vue d’un accord commun sur la future directive. Cependant, les résultats des négociations sont difficiles à prévoir et l’on peut s’attendre à des compromis entre les différents acteurs qui peuvent aboutir à une dénaturation du texte, et plus généralement à ses ambitions.
Récemment, on a pu observer un tel recul concernant la réglementation relative à la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) qui devait viser à rendre obligatoire un reporting de durabilité pour les entreprises ayant des activités en Europe. En effet, la pression exercée par les lobbies économiques pourrait conduire l’Europe à renoncer à cette obligation de reporting[13]. Dès lors, il ne reste plus qu’à espérer que le devoir de vigilance européen ne subira pas le même sort.
Références
[1] Article L 225-102-4 du Code de commerce.
[2] Amnesty International, 21 février 2019, Deux ans après l’adoption de la loi sur le devoir de vigilance, les entreprises dans le viseur des ONG.
[3] Tribunal de La Haye, fondation Urgenda, 24 juin 2015, aff. C/09/456689 / HA ZA 13-1396.
[4] Conseil d’État, Commune de Grande-Synthe II, 1er juillet 2021, déc. n°427301.
[5] Conseil d’État, Commune de Grande-Synthe III, 10 mai 2023, déc. n°467982.
[6] Tribunal administratif de Paris, L’affaire du siècle, 3 février et 14 octobre 2021, req. n° 1904967-1904968-1904972-1904976.
[7] Tribunal de La Haye, Milieudefensie & al. C. RoyalDutch Shell, 26 mai 2021, C/09/571932 / HA ZA 19-379.
[8] Paul Mougeolle, 26 mai 2021, Condamnation de Shell aux Pays-Bas : un tournant majeur vers la responsabilité des multinationales en matière climatique.
[9] Tribunal judiciaire de Nanterre, 30 janv. 2020, ord. réf. n° 19/02833 et 19/02833.
[10] Cour d’appel de Versailles, 10 décembre 2020, n° 20/01692 et 20/01693.
[11] Chambre commerciale de la Cour de cassation, 15 décembre 2021, n°21-11.882 et 21- 11.957.
[12] Tribunal judiciaire de Paris, 28 février 2023, n° 22/53942 et 22/53943.
[13] Les Echos, 13 avril 2023, Finance verte : le cadre européen sur le reporting extra-financier des entreprises en danger.
Impulsée par les nouvelles générations, qui sont attentives dans le cadre de leur recherche d’emploi aux comportements des entreprises et attachées en particulier aux enjeux d’inclusion des minorités, l’entreprise inclusive est encore peu et mal définie.
Le terme d’inclusion n’a cependant rien de nouveau. Autrefois, il était identifié par le terme « d’intégration ». Du fait de l’évolution des mentalités, sa « concrétisation » est, quant à elle, promise à un nouvel essor depuis peu. Ce développement est initié par la combinaison de deux facteurs : les nécessités économiques (l’inclusion serait un outil de performance de l’entreprise) et les revendications sociétales, grandissantes, pour l’intégration de tous.
L’inclusion peut s’entendre comme visant « l’ensemble des actions menées par une entreprise visant à prévenir les situations de discrimination liées notamment au handicap, à l’âge, à l’origine sociale ou la culture, au genre, à l’orientation sexuelle, à l’apparence physique ou encore à la situation sociale »[1].
L’entreprise inclusive est une entreprise où chaque individu a sa place, son utilité et ce quelles que soient ses particularités. Ce type d’entreprise repose sur une « culture de bienveillance » à l’égard de tous et où les particularités de chacun sont valorisées. Les particularités d’un individu relèvent d’un champ très vaste et peuvent s’entendre comme le genre, le handicap, l’orientation sexuelle, l’origine sociale ou culturelle, l’âge, etc. Ce large spectre amène l’inclusion à revêtir de nombreuses formes et pratiques au sein des entreprises.
Que le terme utilisé soit celui d’« inclusion » ou d’« intégration », il ne trouve pas de définition légale et n’est donc pas, en tant que tel, un concept juridique. Ces deux notions relèvent plutôt de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans le domaine social.
Pour l’heure, aucune loi n’oblige les chefs d’entreprise à pratiquer l’inclusion. Seule contrainte légale, la non-discrimination au travail[2]. En l’absence de dispositif juridique, l’inclusion relève d’une démarche volontaire des entreprises qui souhaitent s’engager au-delà de leurs seules obligations légales en matière de prévention des discriminations. La notion d’inclusion est étroitement liée à celle de diversité et de mixité.
Une impulsion des pouvoirs publics
C’est sous l’impulsion des pouvoirs publics que se sont largement développées les politiques d’inclusion. Qu’il s’agisse de lutte contre toutes les formes de discrimination, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou de l’intégration des personnes en situation de handicap. Le législateur a multiplié les dispositifs visant à mieux intégrer les femmes, les personnes handicapées, les jeunes, les seniors[3].
Un sujet de négociation collective
Au-delà de l’influence du législateur, ce sont les entreprises qui ont pris le relais en faisant de l’inclusion un nouveau sujet de négociation collective. Par le biais de cette négociation, les entreprises ont volontairement mis en place des politiques d’inclusion.
Cette mise en place de politiques d’inclusion s’est traduite par l’apparition de nouveaux accords dans les entreprises[4] mais aussi des branches professionnelles. L’accord Mixité-diversité et Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche des sociétés d’assurance, conclu le 2 octobre 2020[5], en est un exemple.
Des avantages pour les entreprises
Le recours à l’inclusion dans les entreprises est un phénomène récent et de plus en plus fréquent. L’entreprise inclusive engendre bien des avantages et le recours à l’inclusion permet aux entreprises de se démarquer par rapport à leurs concurrents.
L’inclusion est, sans aucun doute, un enjeu pour l’image de l’entreprise et pour sa réputation, et les bénéfices pour l’entreprise ne s’arrêtent pas là puisqu’elle est également un facteur d’amélioration de la performance[6]. Contrairement aux idées reçues, la culture inclusive et la performance vont de pair en entreprise. L’avantage économique est donc loin d’être lésé.

Comme le souligne une étude internationale du cabinet Boston Consulting Group[7], un lien étroit existe entre, d’un côté, une culture d’entreprise qui encourage la diversité et l’inclusion et, de l’autre, l’augmentation de l’engagement, de la productivité et de la créativité au sein de l’organisation. Les entreprises qui affichent une diversité supérieure à la moyenne sont plus innovantes que les entreprises dont les équipes sont moins diverses.
L’inclusion aurait également des bienfaits sur la santé physique et mentale des salariés. Ces derniers, se sentant plus heureux au travail, seraient véritablement engagés auprès de leur entreprise. Le bien être des salariés est précieux pour le bon développement de l’entreprise. En effet, les salariés seront d’avantage performants et productifs. Les politiques inclusives constituent également un élément d’attractivité permettant d’attirer, plus facilement, de nouveaux talents et, par la suite, de les conserver. En définitive, l’inclusion est un moteur de performance[8].
Une simple communication institutionnelle ?
Alors que des entreprises s’engagent sincèrement pour les droits de leurs salariés, d’autres ne sont pas aussi sincères dans leur démarche. Il n’est pas exclu que certaines entreprises promeuvent l’inclusion pour de mauvaises raisons, faisant ainsi du « social washing ». En effet, se pose la question des entreprises qui se prétendent inclusives uniquement pour des questions d’image et de réputation. Or, le terme d’entreprise inclusive ne veut rien dire s’il n’y a pas véritablement d’inclusion.
Ce phénomène est désigné par le terme de « social washing » qui s’apparente, tout comme le « green washing », à un coup de communication sans réel engagement derrière.
Il se traduit par une incompatibilité entre le message que l’entreprise véhicule à l’extérieur et sa politique interne. Par exemple, le Directeur Général du groupe MAIF a été récemment mis sur le devant de la scène par divers articles l’accusant de « social washing »[9].
Dans le même ordre d’idées, le 1ᵉʳ juin s’est ouvert le Mois des fiertés, qui célèbre et rappelle les luttes pour les droits des personnes LGBTQI+. C’est aussi une opportunité marketing pour de nombreuses entreprises qui chaque année, à cette période, brandissent le drapeau arc-en-ciel pour booster leurs ventes. Ce phénomène est désigné par le terme de « pink washing », qui désigne une entreprise qui utilise les valeurs LGBT+ pour se donner une fausse image sans que cela soit suivi d’actions concrètes. Cette méthode de communication et de marketing cible les valeurs LGBT+ en vue d’attirer les personnes sensibles à ce sujet. En ce mois des fiertés, bon nombre d’entreprises et de grandes marques ont sorties des collections spéciales LGBTI et qui utilisent ce ressort stratégique comme une opportunité améliorant leur business.

L’entreprise valorisant les différences est, certes, plus rentable, mais devenir une entreprise inclusive est loin d’être aisé puisqu’il est nécessaire, comme le souligne l’Organisation Internationale du Travail[10], de faire évoluer l’organisation, les comportements, la stratégie et la culture au sein de l’entreprise. C’est l’ensemble de l’entreprise qui doit être repensé avec une stratégie fondée sur l’égalité des chances professionnelles et l’inclusion de tous les profils. L’objectif étant d’organiser un changement durable et qui concerne l’ensemble des salariés. Pour ce faire, il faut institutionnaliser un environnement et des méthodes de travail inclusives au quotidien.
L’inclusion occupe désormais une place inédite dans l’entreprise. Elle constitue une réelle opportunité pour l’entreprise en lui permettant de faire face aux défis contemporains. Une certitude apparaît, l’entreprise de demain sera plus inclusive et plus solidaire.
Il est encourageant de voir que la démarche de l’inclusion semble déjà bien engagée dans les entreprises.
Références
[1] L’inclusion, un nouveau défi pour les entreprises, CMS Francis Lefebvre Avocats, Les Echos, 28 mai 2021
[2] Article L1132-1 du Code du travail
[3] Il existe de nombreuses illustrations telle que la loi du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion pour l’emploi par l’activité économique qui a créé le « CDI d’inclusion », destiné aux seniors de 57 ans et plus en situation de chômage longue durée ou qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles.
[4] Exemple d’accord d’entreprise “Accord sur la Diversité et l’inclusion au sein de BNP Paribas SA” du 24 juillet 2020.
[5] Accord du 2 octobre 2020 relatif à la mixitédiversité et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d’assurances
[6] Une étude réalisée par le cabinet Deloitte, intitulée : « Inclusion et diversité : Comment faire de l’inclusion un levier de transformation des organisations ? », affirme que « les entreprises engagées dans une démarche d’inclusion ont près de 60% de chances supplémentaires de voir leurs profits et leur productivité augmenter et d’avoir meilleure réputation » ; https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talen ts-et-ressources-humaines/articles/diversiteet-inclusion.html
[7] Une étude internationale du cabinet Boston Consulting Group (BCG) – « Inclusive Cultures Have Healthier and Happier Workers » met en avant ce lien. https://www.bcg.com/publications/2021/buil ding-an-inclusive-culture-leads-to-happierhealthier-workers
[8] Une étude de France Stratégie intitulée « Responsabilité sociale des entreprises et compétitivité », publié le 7 janvier 2016, démontre que s’engager en RSE est une démarche rentable puisque la RSE apporte à l’entreprise un gain de performance de 13%. https://www.strategie.gouv.fr/publications/re sponsabilite-sociale-entreprises-competitivite
[9]https://www.lejdd.fr/economie/tribune26-entrepreneurs-de-leconomie-socialedenoncent-levolution-du-mouvement-impactfrance-135550
[10] Organisation Internationale du Travail, « Diversité et inclusion : les clés d’une reprise productive et résiliente », 6 avril 2022 Références
Ces dernières années, de nouvelles problématiques font leur apparition en entreprise telle que la question de l’identité de genre. En effet, les personnes transgenres (dont l’identité de genre diffère du sexe qui leur a été assigné à la naissance[1]), non-binaires (ne se définissant pas dans l’un ou l’autre genre[2]) sont de plus en plus présentes dans la société et a fortiori plus présentes dans le monde du travail.
Cette notion d’identité de genre est définie comme la conscience individuelle et intérieure de son genre ressentie profondément par chacun, pouvant correspondre ou non au sexe assigné à la naissance. Cela correspond à la représentation personnelle du corps ainsi que d’autres expressions de genre comme le style vestimentaire[3].
L’évolution du droit sur ce sujet
Pour commencer, la Cour de justice de l’Union Européenne a dans un arrêt du 30 avril 1996 étendu l’interdiction de discrimination[4] pour un licenciement d’une personne étant en conversion sexuelle.

Ce principe est rattaché à celui de l’égalité de traitement en considérant que la personne : “fait l’objet d’ un traitement défavorable par rapport aux personnes du sexe auquel elle était réputée appartenir avant cette opération”.
En ajout des discriminations liées au sexe et à l’orientation sexuelle, le Conseil Constitutionnel a consacré celle sur l’identité de “genre auquel s’identifie une personne, qu’il corresponde ou non au sexe indiqué sur les registres de l’état civil ou aux différentes expressions de l’appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin”[5].
Une loi du 27 janvier 2017[6] a créé cette discrimination en remplaçant le terme “identité sexuelle” en “identité de genre” s’ajoutant à la liste de l’article L.1132-1 du Code du travail : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […]en raison de son identité de genre ».
En entreprise, l’identité de genre d’une personne peut être un obstacle à son embauche ou à son évolution. Cette question de l’identité englobe ainsi la discrimination sur l’apparence physique, sur les restrictions faites par l’employeur des tenues vestimentaires portés par leurs salariés d’un genre ou d’un autre, ce qui peut emporter une inégalité de traitement.
L’égalité de traitement vise à garantir aux salariés une protection contre les décisions “arbitraires” de l’employeur puisqu’il permet aux salariés de bénéficier des mêmes avantages et rémunérations que leurs collègues placés dans une situation identique ou comparable[7].
La discrimination sur l’apparence physique La Cour de cassation a jugé qu’il y avait une discrimination sur l’apparence physique dans deux principaux arrêts[8].
Dans le premier, l’employeur faisait valoir que le port des boucles d’oreilles du salarié, serveur dans un restaurant recevant une clientèle attirée par sa réputation de marque, était incompatible avec ses fonctions. La Cour de cassation a jugé que le licenciement d’un salarié au motif qu’il portait une boucle d’oreille était nul[9] : « En vertu de l’article L.1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique ». Le licenciement reposait sur un motif discriminatoire puisque la décision de l’employeur n’était pas basée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Elle a reconnu la discrimination directe fondée sur l’apparence physique rapportée au sexe.
Le second arrêt est récent et concerne l’interdiction du port de tresses portées en chignon pour un steward[10]. Ce salarié de la société Air France s’était vu être mis à pied à titre disciplinaire puis licencié pour inaptitude le 13 avril 2012 pour s’être présenté avec cette coiffure, ce qui était interdit par le chapitre 50 du référentiel de la société. Ce dernier regroupe les exigences professionnelles applicables au personnel ; il indiquait notamment que « les cheveux doivent être coiffés de façon extrêmement nette. Limitées en volume, les coiffures doivent garder un aspect naturel et homogène. La longueur est limitée dans la nuque au niveau du bord supérieur de la chemise et, pour les femmes, les tresses africaines sont autorisées à condition d’être retenues en chignon[11] ».

Le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes pour demander des dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral pour lequel il a été débouté. La Cour d’appel a confirmé le jugement en première instance en ce que le pouvoir de direction de l’employeur permet d’imposer des contraintes en matière d’apparence physique qui doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Quant à la Cour de cassation, elle a jugé selon les articles L.1121-1 et L.1132- 1 du Code du travail que le salarié avait bien fait l’objet d’une discrimination sur l’apparence physique en lien avec son sexe.
Elle a précisé que « la perception sociale de l’apparence physique des genres masculin et féminin […] ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les femmes et les hommes ». Ce terme renvoyant à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause.
La discrimination était donc directe car le sexe était l’unique critère qui permettait d’interdire les tresses chez les hommes. L’apparence physique étant un critère purement subjectif, l’employeur s’est fondé sur un principe discriminatoire pour fonder sa décision.
La limite au principe de nondiscrimination
L’employeur peut établir des restrictions sur l’apparence physique si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. La Cour de cassation a considéré comme valable le licenciement d’une danseuse du Moulin Rouge en raison de son poids. Sa profession impliquait des critères physiques et esthétiques particuliers donc son apparence physique constituait une exigence professionnelle objective[12].
De plus, la décision de l’ employeur d’interdire le port du bermuda à un salarié au motif que ce vêtement est incompatible avec la profession d’agent technique a été acceptée par la Cour de cassation[13].
Cet argumentaire a été repris pour une salariée exerçant le métier d’agent immobilier qui était habillée en survêtement. Les juges ont considéré que l’employeur pouvait établir une restriction de la liberté individuelle puisqu’elle était en contact avec la clientèle[14]. La liberté individuelle peut être restreinte si l’exigence professionnelle le nécessite.
Cependant, la Cour de cassation limite les restrictions de la liberté individuelle pour que les employeurs ne puissent pas en abuser. Dans les précédents arrêts, elle apprécie la discrimination en raison de l’apparence physique de manière isolée en évitant de la traiter concomitamment avec la question de l’égalité entre les sexes[15].
L’identité de genre est de plus en plus protégée par les juges mais cela se fait au cas par cas. La Cour de cassation avec l’arrêt de novembre 2022, a ouvert la voie à la prohibition de plusieurs discriminations pouvant aller de la différence de traitement en matière de coiffure à toute différenciation des genres dès lors qu’elle ne repose pas sur une exigence professionnelle essentielle et déterminante[16].
Références
[1] « L’Etat qui décide qui je suis. Les personnes transgenres confrontées à des procédures de changement d’état-civil défaillantes ou inexistantes en Europe », Amnesty International. 4 février 2014 Consultable sur le site : https://www.amnesty.fr/focus/transgenre
[2] “Le droit belge du sexe et du genre à la croisée des chemins : vers une pleine consécration de l’autodétermination corporelle et civile des personnes transgenres et intersexes ?”, Revue Juridique Personnes et Familles, n°11, 1er novembre 2019
[3] Amnesty International, «L’Etat décide qui je suis : les personnes transgenres confrontées à des procédures de changement d’état civil défaillantes ou inexistantes en Europe », janvier 2014, https://www.amnesty.org/fr/documents/EUR0 1/001/2014/fr/
[4] CJUE, 30 avril 1996, P./ S., Aff. C-13/94, consultable sur le site : https://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/? uri=CELEX%3A61994CJ0013
[5] Décision n°2016-745 DC du 26 janvier 2017, consultable sur le site : https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2017/2016745DC.htm
[6] Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, JORF 28 janvier 2017, Chapitre IV : Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations
[7] Cyrille Franco, Marie-Sophie Turet, Jurisprudence Sociale Lamy, 555, 10-01-2023, « Quand la Cour de cassation affirme l’égalité capillaire entre les salarié.e.s », consultable sur le site : https://www-lamyline-fr.proxy.scd.univtours.fr/content/document.aspx? idd=DT0007025436&version=2023010
[8] Le Lamy Social, 03/2023, “223- Discrimination fondée sur l’apparence physique”, consultable sur le site : https://www-lamyline-fr.proxy.scd.univtours.fr/content/document.aspx? idd=DT0004734864&version=201 91127&DATA=yjxYACJYrLrnmIABJzwNyn
[9] Cass. Soc., 11 janv. 2012, n°10-28.213
[10] Cass. Soc., 23 nov. 2022, n°21-14.060
[11] Cyrille Franco, Marie-Sophie Turet, Jurisprudence Sociale Lamy, 555, 10-01-2023, « Quand la Cour de cassation affirme l’égalité capillaire entre les salarié.e.s », consultable sur le site : https://www-lamyline-fr.proxy.scd.univtours.fr/content/document.aspx? idd=DT0007025436&version=20230105&DATA=yj xYACJYrLrnmIABJzwNyn
[12] Cass. Soc., 5 mars 2014, n°12-27-701
[13] Cass. Soc., 28 mai 2003, n°02-40-273
[14] Cass. Soc., 6 novembre 2001, n°99-43.988
[15] Cyrille Franco, Marie-Sophie Turet, Jurisprudence Sociale Lamy, 555, 10-01-2023, « Quand la Cour de cassation affirme l’égalité capillaire entre les salarié.e.s », consultable sur le site : https://www-lamyline-fr.proxy.scd.univtours.fr/content/document.aspx? idd=DT0007025436&version=20230105&DATA=yj xYACJYrLrnmIABJzwNyn
[16] Pascal Dupont et Ghislain Poissonnier, Recueil Dalloz 2023 n°10 du 16/03/2023 p.533 “Personnel navigant commercial : il est interdit d’interdire…aux hommes une coiffure autorisée aux femmes”, consultable sur le site : https://cutt.ly/WwiRetpI JUILLET 202 3 NUMERO 2 1 L’intégration des travailleurs séniors
Il est en droit du travail un principe fondamental de non-discrimination qui interdit à un employeur de refuser à une personne l’accès à un emploi ou de prendre une décision à son encontre qui soit fondée sur un motif discriminatoire [1]. C’est un droit que les salariés et demandeurs d’emplois conservent, peu importe leur couleur de peau, leur orientation sexuelle, leur religion… Mais c’est un privilège qu’ils semblent perdre avec l’âge.
En effet, le baromètre 2021 de perception de l’égalité des chances établi par le MEDEF [2] montre que l’âge reste la principale source de crainte de discrimination chez les salariés. Ainsi, 29% des femmes et 23% des hommes craignaient d’être discriminés en fonction de leur âge. Une partie des répondants y voient un frein potentiel à leur évolution de carrière.

Il semble difficile de leur donner tort alors que la France accuse en matière d’emploi des séniors un important retard.
Un taux d’emploi des séniors qui peine à augmenter
En effet, selon l’INSEE le taux d’emploi des personnes ayant entre 55 et 64 ans était de 53,8% en 2020 soit 6,4 points de moins que la moyenne européenne [3] .
Cet écart peine à se combler pour deux raisons qui s’entretiennent entre elles.
La première est que les législations européennes et françaises sont en effet relativement souples en matière de discriminations liées à l’âge. Le droit européen admet dans la directive 2000/78 [4] que les Etats puissent prévoir des mesures discriminatoires liées à l’âge pour certains corps de métiers. A plus forte raison il est possible de justifier une mesure discriminatoire liée à l’âge en invoquant le fait que les conditions d’exercice de l’activité en cause font de l’âge une condition essentielle et déterminante.
Dans cette droite ligne, le droit français a admis plusieurs justifications de mesures discriminatoires liées à l’âge. Un bon exemple de cela est la possibilité de mettre à la retraite d’office un salarié de plus de 70 ans [5].
Si cette souplesse peut relever du bon sens pour certains corps de métiers, cela en devient douteux pour d’autres. On peut facilement comprendre que la baisse des facultés physiques pousse les États à fixer une limite d’âge audelà de laquelle une personne ne peut espérer conserver sa place au sein des forces armées. Il est plus difficile de concevoir que l’âge d’un présentateur d’une émission de télévision devienne problématique au point de pousser son employeur à le licencier. C’est pourtant ce qui est arrivé à Philippe Bouvard, présentateur des grosses têtes, définitivement licencié en 2014.
La seconde est que le travail des séniors a tendance à être une variable d’ajustement des politiques de l’emploi. D’une part, les mesures liées à l’âge sont souvent justifiées par la nécessité d’aider à l’insertion professionnelle des jeunes travailleurs. D’autre part, l’emploi des séniors sert de variable d’ajustement de la masse salariale. Les salariés les plus expérimentés ont les plus hauts salaires de l’entreprise et les avantages en nature les plus conséquents. Les remplacer par des profils juniors permet à niveau de diplôme égal d’économiser des ressources.
Les travailleurs séniors, une ressource pour l’entreprise
Cependant ces deux conceptions sont de plus en plus décriées et démenties par les spécialistes du travail. Considérer la mise à l’écart et le départdes travailleurs âgés comme le seul moyen d’offrir des opportunités aux jeunes travailleurs est inique au vu de l’allongement de l’espérance de vie[6].
Cela revient à faire de la fin de carrière un moment de souffrance pour les séniors qui, éloignés des projets et postes intéressants, ne parviennent plus à trouver du sens dans leur travail.

Incidemment, les dernières années de carrière peuvent également devenir une trappe à pauvreté en empêchant les travailleurs de cotiser assez pour obtenir une retraite à taux plein.
Les pouvoirs publics commencent à se saisir de cette question en mettant en place des mesures en faveur de l’emploi des séniors. Un CDD sénior a par exemple été créé en 2006. Il peut durer jusqu’à 36 mois et permet à l’entreprise qui embauche un sénior de bénéficiers d’aides publiques. Un CDI inclusion pour les publics séniors existe également depuis décembre 2020 [7] . Enfin, il est possible dans une certaine mesure de cumuler rémunération et pension de retraite.
L’Etat a également renforcé les protections des séniors dans le cadre des licenciements économiques [8] et des PSE [9] . L’adoption du projet de loi portant réforme des retraites début 2023 risque cependant de rebattre les cartes en la matière. Mécaniquement, l’allongement de la durée de cotisations va entrainer l’augmentation de la population des travailleurs séniors en repoussant l’âge de départ à la retraite, augmentant donc la pression sur cette population déjà précaire.

Des négociations sont en cours avec les organisations patronales pour accompagner cette transition. La mise en place de l’index sénior, des dispositifs de retraite progressive et la prise en compte des carrières longues sont les pistes principales actuellement sur la table. Le but est de donner aux entreprises les moyens de prendre en compte les besoins de cette nouvelle population de travailleurs entre 62 et 64 ans qui aura besoin d’un accompagnement spécifique.
La tâche sera difficile. Faut-il en conclure qu’elle est impossible ? Certainement pas, même si c’est sans doute là l’un des plus grands défis de l’entreprise du XXIe siècle : arrêter de penser l’emploi en termes de valeur comptable mais commencer à raisonner en termes de valeur ajoutée.
Cela passe par la valorisation des compétences, mais également de leur capacité à les transmettre. Là réside la valeur des travailleurs séniors : dans leur expérience, leur réseau, leurs maitrise des processus et techniques [10] .
Des initiatives émergent dans le secteur privé : dispositif talent seniors dans le réseau APEC, intégration de la mobilité des séniors dans la politique de gestion des parcours de l’emploi et des compétences chez BNP Paribas, développement des dispositifs facilitant le recrutement des salariés de plus de 50 ans au Crédit agricole…
Ainsi, favoriser et sécuriser l’emploi des travailleurs séniors, c’est leur permettre de transmettre leurs connaissances et leur donner une chance d’apprendre de leurs cadets. Voilà comment on créé une dynamique vertueuse à même de nourrir l’entreprise moderne.
Références
[1] Article L1132-1 du code du travail
[2] Baromètre de perception de l’égalité des chances – 2021 – MEDEF – Consultable sur : https://www.medef.com/uploads/media/defa ult/0019/98/14110-guide-synthese-barometrediversite-2021.pdf
[3] Europe et emploi – 2020 – INSEE – Consultable sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5392024 ?sommaire=5392045
[4] Directive 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail
[ 5 ] A r t i c l e L 1 2 3 7 – 4 d u c o d e d u t r a v a i l e t s u i v a n t s
[ 6 ] F a u r i e, I., F r a c c a r o l i, F., & a m p; B l a n c, A. L. (2008). Âge et travail : des études sur le vieillissement au travail à une approche psychosociale de la fin de la carrière professionnelle. Travail Humain, Vol. 71
[7] Mesures séniors, Ministère du travail du plein emploi et de l’insertion, 2022, Consultable sur : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et- insertion/mesures-seniors/
[8] Article L1233-5 du code du travail
[9] Article L1233-61 du code du travail
[10] S. Cuilière « Trop vieux, trop chers, trop qualifiés : 5 idées reçues sur l’emploi des seniors » 5 juillet 2021, Welcome to the Jungle, consultable sur : Trop vieux, trop chers : 5 idées reçues sur l’emploi des seniors, consultable sur : https://www.welcometothejungle.com/fr/arti cles/idees-recues-emploi-senior-amelie-favre- guittet
Il fut un temps où la démocratie prônait sur le parquet des tribunaux français. Dans l’hémicycle présidaient le juge, les magistrats, le public, envoûtés par ces mots prononcés, puis le verdict. Dans les procès jouant les condamnations criminelles les plus sévères, ceux ayant comme portée de bouleverser considérablement la vie des parties, le sort du misérable était retranché entre les mains innocentes et candides des quelques citoyens, qui, après un débat quelque fois houleux et vigoureux décidaient de la peine infligée.

L’une des formes les plus symboliques de la démocratie participative en matière judiciaire semble vouée à disparaître. La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, institutionnalise sur tout le territoire français de nouvelles cours criminelles menaçant considérablement la démocratie judiciaire, et limitant corrélativement le rôle du jury populaire.
C’est au lendemain de la Révolution de 1789 que les révolutionnaires décident de rendre le pouvoir judiciaire au peuple, avec l’instauration du jury populaire. Le peuple français souhaite rompre avec le système judiciaire de l’Ancien droit, celui de la justice du Roi, par préférence au système judiciaire anglais qui connaissait déjà le jugement par les pairs. Le principe du jury est adopté par la Constituante le 30 avril 1790, et depuis lors, le jury populaire n’a jamais quitté le paysage français malgré les nombreux remaniements portés à son principe.
La destinée de l’institution du jury populaire se dessinait déjà depuis plusieurs années dans l’horizon. La loi du 23 mars 2019 [1] , portant sur la création des cours criminelles départementales (CCD) composées uniquement de 5 magistrats, balaye la participation citoyenne. Sa compétence se limite au jugement en premier ressort, des majeurs non récidivistes, pour des crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle, et pour le reste, si l’une de ces conditions n’est pas remplie, c’est la cour d’assises classique qui sera compétente.
Si initialement cette loi prévoyait la mise en place des cours criminelles, cela ne devait être qu’à titre expérimental, dans certains départements listés et ce, pour une durée de 3 ans. C’était sans compter sur la généralisation de ces cours criminelles sur l’ensemble du territoire national.
En effet, depuis le 1er janvier 2023, le jury populaire connaît un recul historique, son champ de compétence est considérablement restreint. Alors que la réforme ne devait concerner qu’une quinzaine de départements seulement, elle est désormais étendue sur tout le territoire national. Cet effacement du jury populaire ne seraitil finalement pas le prélude de sa mort certaine ?
Les motivations de la réforme.
Tous les ans, 20 000 citoyens étaient tirés au sort sur les listes électorales afin de participer à la justice, au lendemain de la réforme, ils ne seront plus que 10 000. Pourquoi ? Pour quelles raisons le jury populaire, héritage de la Révolution française, estil menacé ? La réforme poursuit trois objectifs principaux : garantir aux parties un délai raisonnable de jugement, réduire les coûts et éviter la correctionnalisation.
Le délai raisonnable.
Le premier objectif est celui de réduire le temps des procédures criminelles pour les justiciables, celui du droit d’être jugé dans un délai raisonnable. L’influence de la Cour européenne des droits de l’Homme et de sa jurisprudence est prépondérante en la matière [2] puisque la France se trouve régulièrement condamnée en raison de ses délais de jugement trop longs.
La correctionnalisation. La création des CCD permettrait d’éviter la correctionnalisation des crimes. C’est « une technique procédurale par laquelle le ministère public et le juge de jugement négligent volontairement un élément constitutif ou une circonstance aggravante d’un crime » [3] .

Les affaires les plus concernées par ce phénomène sont les crimes sexuels qui sont bien trop souvent requalifiés en délits afin de les voir juger devant le tribunal correctionnel. La correctionnalisation était perçue comme un mal nécessaire, faute de moyens financiers et suffisants pour respecter un délai de jugement raisonnable par les cours d’assises. Par la mise en place des CCD, la procédure se trouve simplifiée en raison de l’engagement de moyens humains et financiers réduits. Ces nouvelles cours permettraient de voir juger les crimes sexuels comme tels, revêtus de leurs véritables qualifications.
L’assurance d’un délai de procédure plus court, la réduction de la charge économique des jurés, la diminution de la correctionnalisation, nous dira-t-on. Mais ne serait-ce pas finalement rien d’autre qu’un recul démocratique sans précédent ?
L’œuvre de la justice étant profondément sociale, comment expliquer que l’intérêt budgétaire puisse faire naître une telle atteinte à la démocratie ?
La souveraineté populaire.
Les crimes sexuels, faits d’actualité et enjeux majeurs de notre société, usuellement jugés devant les jurés, ne le seront donc plus que devant des magistrats. C’est l’exclusion des citoyens de leur système judiciaire, l’atrophie de la démocratie participative, dans une ère où : « le rapport conclusif des Etats généraux de la justice plaide pour leur rapprochement » . La défiance citoyenne face à la justice n’est plus à prouver. L’éviction du peuple [4] des salles d’audience paraît dès lors quelque peu malvenue.

Détenteurs de la souveraineté populaire , [5] le jury est l’assurance d’un lien continu entre citoyen et justice. Il y a des causes fondamentalement sociétales, dans lesquelles le peuple, acteur de la société, doit participer. Un jugement rendu par lui, voilà une représentation effective de la pensée citoyenne. C’est l’assurance d’une cohérence certaine entre le pouvoir judiciaire et l’opinion publique.
Le principe d’oralité des débats.
C’est sur ce principe que repose la participation populaire. Il conduit à une lecture simplifiée du droit, une andragogie nécessaire favorisant de surcroît la reconstruction du lien social.
Ce temps d’écoute menant à une meilleure intelligibilité du droit pour tous, celui permettant à ces quelques citoyens de prendre conscience de l’impact de leur décision, sera désormais évincé par les cours criminelles départementales.
L’oralité en la matière joue un rôle prépondérant. C’est une intimité exposée, des vices et des vies « complexes et nuancées » présentés et débattus dans l’hémicycle. Les jurés, citoyens issus de la société civile, jugent leurs semblables portés par leur intime conviction. Bien que « dépositaires d’une décision qui leur appartient » [6] , ils se prononcent sur le sort d’une vie.
Il n’est pas fait une application stricte de la lettre du législateur. C’est en parfaite considération des éléments déterminants de l’affaire que la peine sera infligée par ces quelques citoyens. Ils sont la représentation de la volonté unanime d’une nation. Empêcher une telle démocratie participative n’auraitil d’autres effets que d’étouffer peu à peu la voix des citoyens sur des causes d’intérêt général ?
Une réelle utilité ?
L’expérimentation faite depuis ces trois dernières années rend compte d’un échec amer, tant car elle n’a pas permis la célérité de la procédure ni même pu mesurer aucune forme de décorrectionnalisation.
À cela s’ajoute que la nécessaire mobilisation de quatre magistrats contre deux en cour d’assises ne fait que détourner ces derniers de leurs fonctions principales. C’est le bilan dressé par la Conférence des bâtonniers, réunie en assemblée générale le 27 janvier dernier. Elle votera une motion d’opposition aux cours criminelles départementales dont elle « déplore la généralisation à l’ensemble du territoire national depuis le 1er janvier 2023, nonobstant le bilan négatif dressé après 3 années d’expérimentation et de suivi » [7] .
Le droit concerne l’ensemble de la nation. Il est l’outil fondamental d’un système démocratique. La justice permet le maintien d’un ordre social essentiel. N’est-il pas dès lors légitime, voire capital pour les citoyens de participer à l’instrumentation de la justice ?
L’exclusion du peuple des tribunaux ne fait que renforcer le gouffre déjà existant entre les français et l’intelligibilité des décisions de justice. C’est consolider la rupture entre société et justice. Cette entrave à l’âme de la justice ne peut se justifier par des considérations qui, de toute évidence, n’ont pas prouvé leur efficacité.
« CCD e s t à l a foi s l’ a c ronyme d’un « Cr ime Cont r e l a Démoc r a t i e » e t d’une « Chimè r e Coût eus e e t Dé c e v ant e » . » [8]
Références
[1] MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Loi n° 2019-2022 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, JORF n° 0071 du 24 mars 2019 texte n°2.
[2] CEDH, 12 mai 2022, Req. 43078/15, Tabouret c/ France
[3] CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, PUF, 2018, « Correctionnalisation judiciaire », p. 277.
[4] Extrait de la pétition « Préservation du jury populaire de cour d’assises », publié le 06/01/2023
[5] Extrait du mémoire de Faustine Kuras, « Le jury populaire, histoire d’une institution démocratique fragilisée », p.49
[6] Benjamin Fiorini, « Disparition du jury populaire dans les procès » Franceinfo, 21 décembre 2022: https://france3- regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pascalais/boulogne-mer/disparition-du-jurypopulaire-dans-les-proces-benjamin-fioriniuniversitaire-de-boulogne-mene-la-fronde-dumonde-de-la-justice-2679784.html
[7] Conférence des bâtonniers, « La Conférence des bâtonniers vent debout contre la généralisation des cours criminelles départementales », La Semaine Juridique Edition Générale n° 06, 13 février 2023, n°225
[8] Patrick BAUDOIN, président de la LDH, « Préservation du jury populaire de cour d’assises – Abandon des cours criminelles départementales », le 6 janvier 2023

